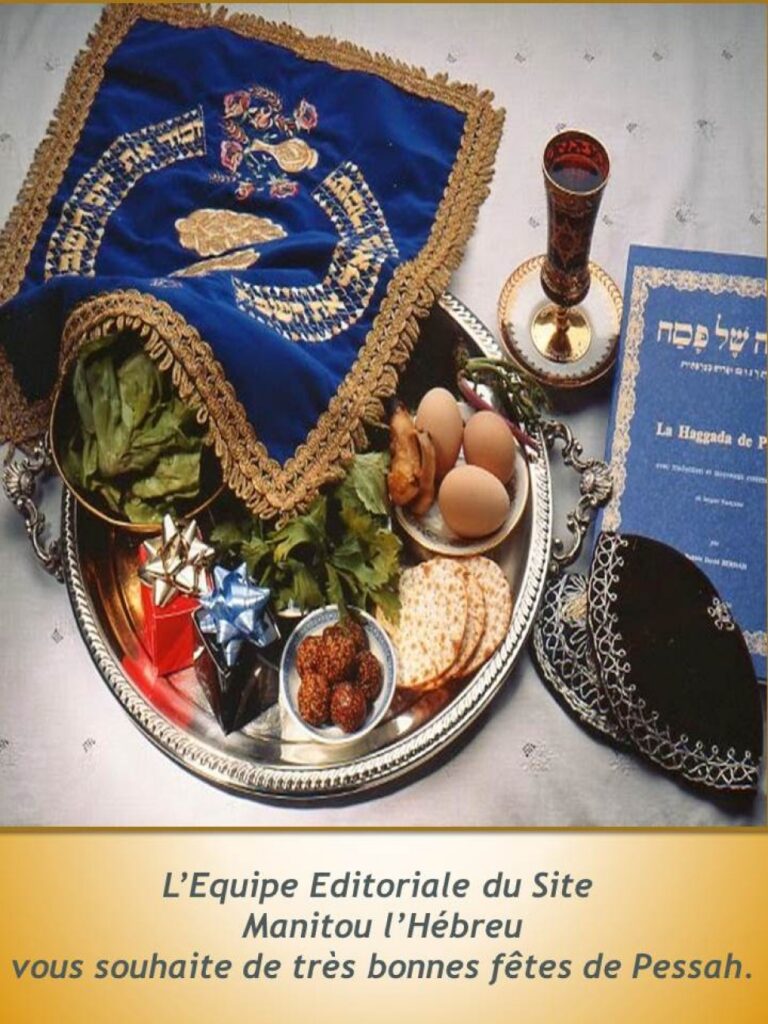פרקי אבות פרק א, משנה א: משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי, וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ, וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים, וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים, וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה. הֵם אָמְרוּ שְׁלשָׁה דְבָרִים: הֱווּ מְתוּנִים בַּדִּין, וְהַעֲמִידוּ תַלְמִידִים הַרְבֵּה, וַעֲשׂוּ סְיָג לַתּוֹרָה. Les Pirké Avot — traité des Pères — sont un ensemble de michnayot qui traitent de morale pratique. Or, le titre hébraïque de ce traité place cet enseignement de la morale dans la perspective d’un héritage, c’est-à-dire transmis par les Pères. Ce titre indexe l’enseignement de la morale à l’indice paternité.C’est l’être Père qui a la capacité, la prérogative d’enseigner la morale, alors que c’est le maître qui enseigne la Thora, la loi.Ce courant de transmission d’un héritage culturel entre cette manière d’être « père » et la manière d’être « fils » – qui semble lui être opposée – est d’ailleurs un sujet qui préoccupe la génération actuelle dans les différentes dimensions de ce que l’on appelle dans la civilisation occidentale, la contestation.Cette première question restera donc en filigrane : pourquoi l’enseignement talmudique a-t-il tenu à attribuer l’enseignement de la morale pratique, de la pédagogie morale au Père, alors qu’habituellement l’enseignement de la tradition passe plutôt par la personnalité du maître ? Il existe une sorte de « bipolarité » d’identité dans la société hébraïque, entre d’une part Abraham, qui est le prototype du Père (c’est d’ailleurs inscrit dans son nom : le père élevé אב-רם), et d’autre part Moïse, le maître. Ce parallèle entre héritage par Abraham et fidélité par Moïse se retrouve dans l’histoire contemporaine de l’identité juive qui fait actuellement l’objet d’un immense travail de mutation. Mutation porteuse d’un certain nombre de crises tant historiques qu’idéologiques ou politiques, déjà indiquées dans l’enseignement des Pirké Avot. Ces thèmes de l’enseignement de la tradition hébraïque concernent donc un problème très précis, celui d’un travail d’enfantement, de mutation, de l’identité juive contemporaine, travail qui s’inscrit à l’intérieur des crises de croissance de l’humanité de notre temps. Cette mutation d’identité est analogue à ce qui s’est passé il y a plus de trois mille ans, au temps de la sortie d’Egypte. Un ensemble de communautés juives procédant de paysages culturels différents, d’équations personnelles différentes, se trouvent en marche vers une identité réunificatrice qui se dessine déjà, non sans problèmes.La Bible raconte, qu’au temps de la sortie d’Egypte, le peuple hébreu était formé de tribus, de familles, qui prenaient conscience de leur identité « Israël » d’abord à l’échelle individuelle. Et le travail de mutation qui s’est produit en ce temps-là a consisté à tenter de faire exister une nation à partir d’un ensemble de définitions individuelles ou de fidélités personnelles, à essayer de donner une extension collective à l’héritage des Patriarches à travers différentes fidélités personnelles qui pouvaient être contradictoires entre elles, et donc génératrices de conflits.De notre temps, la démarche de mutation est très analogue. En effet, à partir de toutes les communautés de la galout — de l’exil juif —, chacune à sa manière, se dessine un mouvement d’unification d’identité autour du fait « Israël ». Il est donc inévitable, comme au temps de la sortie d’Egypte, que cette mutation contemporaine soit également génératrice de conflits et de problèmes.La société de l’Israël contemporain se trouve confrontée à des situations que la Bible a déjà décrites, et qui sont reprises par le Talmud, en particulier par les Pirké Avot.— De notre héritage d’Abraham vient le principal problème d’identité concernant le destin d’Israël : le conflit judéo-arabe. D’une part, la filiation d’Israël à travers Isaac en Abraham et, d’autre part, celle du monde arabe à travers Ismaël, en Abraham lui aussi. Et cette première polarité sur le thème de l’héritage d’Abraham, comme le raconte la Bible, redevient un problème contemporain, de mutation d’identité, qui nous concerne centralement.— Notre relation de fidélité à Moïse, en tant que maître d’Israël, est la cause d’un conflit ou d’une opposition, dans la société d’Israël aujourd’hui, entre une identité juive qui se définirait comme « religieuse » et une identité juive qui se définirait comme « non-religieuse ».Deux conflits essentiels menacent donc l’avenir de cette gestation d’identité d’Israël. L’un par la périphérie, c’est le conflit judéo-arabe, qui se situe à l’intérieur de l’identité d’Abraham, l’autre au centre, c’est le conflit entre judaïsme religieux et judaïsme laïque — pour employer des termes de la civilisation occidentale — qui, lui, se situe à l’intérieur de toute l’histoire des rapports entre Moïse et la société d’Israël de son temps.A travers ces deux sortes de conflits, on retrouve également le conflit des pères et des fils. A l’échelle de la personne humaine, certains — ce sont ceux-là les pères — se définissent par communion absolue avec Israël comme identité collective, et dans une fidélité collective à l’héritage de tous, et d’autres se définissent seulement dans une relation individuelle. Le conflit entre les pères et les fils ne fait que traduire au niveau de l’existence individuelle, le travail de gestation d’une harmonie qui se cherche entre une identité collective et une identité perçue à l’échelle individuelle.Derrière ces thèmes de l’enseignement traditionnel, tels que les présente la Michna, et tels qu’ils sont formulés de façon plus précise encore dans les textes des kabbalistes, apparaît le thème d’un conflit métaphysique entre forces de la patience et forces de l’impatience. Dialectique entre patience et impatience, très parallèle à la dialectique entre l’Etre père et l’Etre fils, à la dialectique entre l’identité collective et les droits de l’existence individuelle ; et surtout dialectique entre la perspective de l’héritage et la perspective de la fidélité.La notion qui récapitule l’ensemble de ces thèmes est une notion très paradoxale du vocabulaire biblique lorsqu’il désigne l’identité d’Israël. En hébreu c’est זרע קודש. 1. זרע קודש- POSTÉRITÉ SAINTE זרע — signifie une postérité, une descendance. C’est donc une allusion à une identité qui se reçoit par héritage, sans que ne s’introduise aucune option idéologique, sans qu’intervienne le critère du mérite de fidélité à un certain nombre de valeurs qui dépasseraient l’hérédité pure et simple.Mais le terme de זרע — postérité — se trouve tout de suite modifié par (dans l’original : adjectif) קודש qui signifie le saint, le sacré. Il